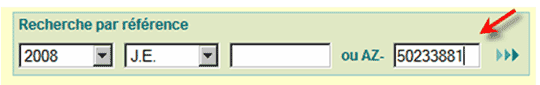L’article 52 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) stipule que : Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.
Il s’agit de normes minimales de travail. Les conventions collectives et contrats de travail peuvent prévoir des conditions plus avantageuses pour les employés.
Le recours le plus fréquent est la réclamation d’heures supplémentaires par la Commission des normes du travail. Pour les entreprises de juridiction fédérale, le recours est l’appel en matière de recouvrement de salaire en vertu du Code canadien du travail (C.C.T.); la semaine normale de travail est prévue à l’article 169 (1) a) C.C.T.).
En ce qui concerne les employés syndiqués, la réclamation d’heures supplémentaires est faite par l’entremise d’un grief du syndicat; chaque convention peut prévoir des règles adaptées aux besoins de l’entreprise, pourvu que les normes minimales soient respectées.
Par ailleurs, en matière de lésions professionnelles d’autres situations se présentent.
D’abord, le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR). L’article 65 de la Loi sur les accidents du travail et les lésions professionnelles (LATMP) impose un seuil minimum de revenu brut annuel qui correspond au salaire minimum, en tenant compte du taux horaire et de la durée de la semaine normale de travail prévus à la Loi sur les normes du travail. L’article 6 de la LATMP fait un renvoi à la semaine normale de travail prévue par la Loi sur les normes du travail.
Dans le cadre d’une assignation temporaire de travail, l’article 180 précise que : « L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer. »
Enfin, l’article 242 de la LATMP, se trouvant au chapitre du « Droit au retour au travail » prévoit la rémunération du salarié durant l’absence :
« Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. »
« Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés. »
Par l’entremise de l’article 32 de la LATMP, un travailleur peut porter plainte à la CSST lorsqu’il croit avoir été l’objet d’une mesure prévue à cet article, notamment « des mesures discriminatoires ou de représailles ou […] toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi ».
Les exemples qui suivent reflètent bien le type de situations où des dossiers concernant des heures supplémentaires n’ont pas pu être réglés entre les parties et se sont rendus devant un tribunal.
GRIEFS
L'employeur, un centre de santé et de services sociaux, ne peut refuser d'accorder une libération syndicale en alléguant que celle-ci l'obligera à payer des heures supplémentaires à un autre salarié.
Le syndicat conteste le refus de l'employeur d'accorder les libérations syndicales internes et externes prévues à la convention collective. Celle-ci énonce que ces libérations sont accordées pourvu que l'employeur, en l'absence du salarié, puisse assurer la continuité des activités. L'employeur soutient qu'il refuse d'accorder les libérations syndicales lorsque l'absence du salarié entraîne l'attribution d'heures supplémentaires. Selon lui, il n'a pas l'obligation d'accorder des heures supplémentaires afin de permettre l'exercice des libérations syndicales. Le syndicat fait valoir que l'augmentation des coûts ne constitue pas un motif prévu à la convention collective autorisant à refuser les libérations syndicales. Il réclame des dommages-intérêts pour chaque refus d'une libération syndicale.
Décision
L'analyse de la convention collective révèle que les parties se sont exprimées clairement lorsqu'elles ont voulu prévoir des situations ne devant pas entraîner l'attribution d'heures supplémentaires. La clause relative aux libérations syndicales ne comporte pas une telle restriction. La seule condition pour l'attribution des libérations syndicales concerne la continuité des services. Ainsi, le refus de payer des heures au taux majoré ne peut constituer un motif valable. En rejetant les demandes de libération syndicale pour ce motif, l'employeur a contrevenu à la convention collective. Quant au syndicat, il a subi de nombreux inconvénients en raison de ces refus répétés. Par conséquent, le Tribunal ordonne à l'employeur de constituer un fonds de 4300 $ — équivalant à 300 $ par libération syndicale refusée —, qui servira exclusivement à payer des heures supplémentaires aux salariés remplaçant des collègues en libération syndicale.
Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Est du Québec et Centre de santé et de services sociaux de La Mitis (grief syndical)* SOQUIJ AZ-50550204 NDLR : Requête en révision demandée.
L'argument du syndicat selon lequel les heures travaillées un vendredi après-midi durant la période où l'horaire d'été est en vigueur devraient être rémunérées à taux majoré est rejeté.
Les deux plaignantes occupent des fonctions syndicales. Le vendredi 7 juillet 2006, elles ont obtenu une libération syndicale avec solde afin d'assister à un arbitrage. L'audience a duré toute la journée. Elles travaillaient alors selon l'horaire estival, soit de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h 30 à 12 h 30 le vendredi. Selon cet horaire, les salariés ne travaillent que 32 heures par semaine, mais sont rémunérés 35 heures. Les plaignantes ont été rémunérées pour une période de 35 heures durant la semaine du 3 juillet. Elles soutiennent cependant que les heures effectuées le vendredi après-midi en libération syndicale devaient être payées au taux des heures supplémentaires. De son côté, l'employeur fait valoir que les salariés en libération syndicale ne peuvent être rémunérés au-delà de l'horaire habituel, puisqu'il n'exerce aucun contrôle sur les heures travaillées et que celles-ci ne constituent pas du « temps supplémentaire » au sens de la convention collective.
Décision
L'employeur a raison de prétendre que le congé pour activités syndicales ne vaut que pendant les heures de travail normales des salariés qui en bénéficient. S'il est vrai qu'il n'existe aucune clause stipulant expressément que les libérations syndicales ne sont attribuées que pour les heures normales de travail, cette intention peut néanmoins être inférée de l'ensemble des dispositions pertinentes de la convention collective. En effet, les clauses relatives aux libérations syndicales prévoient que le salarié peut s'absenter de son travail pour des activités syndicales. Or, le fait de permettre à une personne de s'absenter présuppose qu'elle devrait normalement être à son travail au moment de sa libération syndicale. Il faut donc nécessairement en conclure que toutes les libérations doivent avoir lieu pendant l'horaire normal. Cela est confirmé par d'autres clauses prévoyant que le salarié en libération syndicale s'occupe des activités syndicales « durant les heures de travail ». Ainsi, ce n'est qu'au cours de la libération syndicale survenant pendant l'horaire habituel qu'il y a maintien du traitement. Par ailleurs, le temps effectué en libération syndicale ne peut constituer des heures supplémentaires au sens de la convention collective. Celle-ci prévoit que de telles heures doivent être approuvées préalablement par le supérieur immédiat ou avoir été faites à sa connaissance et sans objection de sa part.
Syndicat du personnel de soutien de l'Université du Québec en Outaouais et Université du Québec en Outaouais (griefs individuels, Lucie Champoux et une autre), SOQUIJ AZ-50514113
L'arbitre a rendu une décision déraisonnable en concluant que l'article 57 paragraphe 4 de la L.N.T. s'appliquait au cas à l'étude et que le plaignant — un policier — avait droit à 140,5 heures à taux majoré pour le temps consacré à l'étude et aux travaux scolaires à l'occasion d'un cours autorisé par l'employeur.
Le plaignant est policier, préposé en identité judiciaire, depuis juillet 2002. Du 25 août au 10 octobre 2003, il a suivi un cours sur l'identité judiciaire donné par le Collège canadien de police. L'initiative de cette participation est contestée : le syndicat allègue que l'employeur a exigé que le plaignant s'inscrive à ce cours, alors que l'employeur affirme avoir simplement acquiescé à la demande du plaignant. Selon la convention collective, l'approbation de l'employeur entraîne la rémunération du policier durant la formation ainsi que le paiement des frais d'inscription et des ouvrages pédagogiques. Le 6 février 2004, le plaignant a déposé un grief réclamant 140,5 heures à taux majoré pour le temps qu'il avait consacré à l'étude et aux travaux scolaires durant sa formation. L'arbitre a eu recours à la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), car elle lui paraissait plus généreuse que la convention collective. L'article 57 paragraphe 4 prévoit qu'un salarié est réputé être au travail durant « toute période de formation exigée par l'employeur ». Interprétant le concept de formation comme englobant tout mécanisme d'apprentissage, l'arbitre a conclu au droit du plaignant au paiement des heures consacrées à l'étude et aux travaux, en sus de la présence en classe, et a accueilli le grief. L'employeur demande la révision judiciaire de cette sentence. Il soutient que l'arbitre a erré en décidant qu'il avait exigé que le plaignant suive ce cours.
Décision
Depuis l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 2008-03-07), 2008 CSC 9, SOQUIJ AZ-50478101, J.E. 2008-547, D.T.E. 2008T-223, [2008] 1 R.C.S. 190, il existe deux normes de contrôle : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La norme de la décision correcte est réservée aux cas suivants : certaines questions de droit, y compris les questions de compétence, celles qui revêtent une importance capitale pour le système juridique et sont étrangères au domaine d'expertise du décideur de même que celles qui sont relatives à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents. Pour sa part, la norme de la décision raisonnable, empreinte de déférence, s'impose dans les questions purement factuelles, celles où le droit et les faits sont indissociables de même que dans les décisions d'organismes disposant d'un vaste pouvoir discrétionnaire. Le caractère raisonnable d'une décision tient à sa motivation, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu'à son appartenance aux déterminations possibles acceptables et justifiables au regard des faits et du droit. La Cour n'est plus tenue de se livrer à une analyse exhaustive relativement à la norme de contrôle appropriée : cette analyse est réputée avoir déjà été effectuée.
En l'espèce, l'évaluation de l'interprétation d'un droit prévu à la convention collective et de sa comparaison avec une condition minimale de travail ne requiert pas une analyse exhaustive, car le tribunal bénéficie des enseignements de la jurisprudence. Il en ressort que l'arbitre exerce sa compétence accessoire lorsqu'il décide de cette comparaison. Sa sentence est donc soumise à la norme de la décision raisonnable. Quant au degré de déférence, à l'intérieur de la norme de la raisonnabilité, en ce qui a trait à l'expertise de l'arbitre, celui-ci jouit d'une compétence spécialisée en matière d'interprétation et d'application d'une convention collective. Cette expertise lui vaut une grande déférence lorsque la question en litige relève directement de son champ de compétence. Il en va autrement en matière d'interprétation de la loi, compétence spécialisée de la Commission des relations du travail. En l'espèce, après avoir décidé que la convention était muette relativement au droit au paiement des heures supplémentaires accumulées pendant la formation, l'arbitre a décidé que ce droit existait dans la Loi. Ce faisant, il statuait sur le sens de l'article 57 paragraphe 4 de la Loi et cet exercice échappe à sa compétence spécialisée. Or, c'est l'expertise quant à la question précise soulevée qui détermine le degré de déférence, et non l'expertise générale du décideur administratif.
Quant au fond, l'interprétation de l'arbitre selon laquelle les heures d'étude personnelle constituent de la formation au sens de l'article 57 paragraphe 4 de la L.N.T. est raisonnable. Sa conclusion selon laquelle l'employeur avait exigé du plaignant qu'il s'inscrive à cette formation est toutefois déraisonnable, car elle ne repose sur aucune preuve. En effet, contrairement à certaines affaires où un employeur a unilatéralement inscrit un salarié à une formation, on ne trouve ici aucune trace d'une telle initiative patronale. Que la formation soit accessible et que l'employeur approuve la participation de l'un de ses policiers est une chose; qu'il l'ait requise en est une autre. D'autre part, lors de son inscription au cours, le plaignant détenait le poste de préposé à l'identité judiciaire depuis plus d'un an; la réussite de ce cours ne constituait donc pas une condition d'embauche ni une condition de maintien dans l'emploi. Ainsi, la non-applicabilité de l'article 57, paragraphe 4 de la L.N.T. était la seule conclusion qui s'imposait. Le libellé de cet article ne peut rationnellement soutenir la conclusion de l'arbitre. Son interprétation est donc déraisonnable, voire incorrecte.
Collines-de-l'Outaouais (MRC des) c. Mallette* SOQUIJ AZ-50514048
Note de l’auteur : Requête pour permission d'appeler accueillie (C.A., 2008-12-05), 500-09-019098-086, 2008 QCCA 2327, SOQUIJ AZ-50525256
L'horaire de travail ne constitue pas un avantage lié à la fonction; un opérateur-concierge dans un aréna transféré dans une fonction où il n’a pas l’occasion de faire des heures supplémentaires ne peut revendiquer son ancien horaire en vertu de la clause prévoyant le maintien des avantages dans les cas d'abolition de poste.
Le plaignant travaillait à titre d'opérateur-concierge à l'aréna. À la suite de la fermeture de l'aréna, il a été transféré dans une fonction de chauffeur-opérateur C au garage municipal. Il soutient que l'employeur n'a pas maintenu certains avantages dont il bénéficiait dans son ancien poste. La convention collective prévoit que le salarié permanent dont le poste est aboli doit être transféré sans perte de traitement dans une fonction équivalente comportant les mêmes avantages. Le plaignant affirme d'abord que l'employeur n'a pas maintenu trois primes auxquelles il avait droit, soit la prime versée lorsqu'il devait assumer les fonctions de chef d'équipe, la prime de quart versée lorsqu'il devait travailler entre 16 h et 6 h 30 et la prime d'opérateur-concierge versée pour compenser l'inconvénient que représentait l'interdiction qui lui était faite durant une période de l'année de poser sa candidature à des postes temporaires. Ensuite, il soutient que son transfert a entraîné la perte de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, ce qui constituait, selon lui, un avantage. Il affirme aussi que l'employeur aurait dû maintenir son ancien horaire. Enfin, à la suite de son transfert, il a cessé d'être affecté occasionnellement à la fonction supérieure d'homme de maintenance, ce qui constituait aussi un avantage, d'après lui.
Décision
L'obligation de maintenir les mêmes avantages à la suite d'un transfert dans une fonction équivalente vise les avantages intrinsèques ou inhérents à la fonction occupée et non les avantages qui peuvent y être associés de façon accessoire ou circonstancielle. Par ailleurs, selon son sens général, l'avantage constitue une condition qui s'ajoute au salaire de base, sous forme de salaire indirect, et qui augmente le revenu. Les primes réclamées par le plaignant ne constituent pas des avantages intrinsèques à la fonction d'opérateur-concierge. En effet, ces primes sont versées lorsque le salarié doit occuper temporairement une fonction supérieure ou encore lorsqu'il doit travailler selon un horaire particulier. Il s'agit de sommes versées afin de compenser un inconvénient ou une responsabilité particulière que le salarié doit assumer. Quant à la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires, elle constitue un avantage circonstanciel associé au fait de devoir travailler en sus des heures normales ou la fin de semaine. Cet avantage peut profiter à tout salarié régi par la convention. D'autre part, le fait d'occuper une fonction qui rend son détenteur plus susceptible d'être appelé à effectuer des heures supplémentaires ne représente pas nécessairement un avantage. À cet effet, la notion d'« avantage » peut être particulièrement subjective. Ainsi, ce qui peut paraître avantageux à certains sera perçu comme désavantageux par d'autres, et le travail supplémentaire en est un bon exemple. Par ailleurs, le plaignant ne peut exiger le maintien de la rémunération qui lui était versée lorsqu'il devait occuper la fonction supérieure d'homme de maintenance. Une telle rémunération constitue un avantage lié au fait d'occuper une fonction supérieure et non à son ancienne fonction d'opérateur-concierge. Enfin, l'horaire particulier dont il bénéficiait dans son ancienne fonction ne constitue pas un avantage. Un horaire de travail n'ajoute rien au salaire de base d'un salarié, ni directement ni indirectement.
SCFP, section locale 1009 et Terrebonne (Ville de), (Alain Labbé), SOQUIJ AZ-50562983
Les avis disciplinaires remis aux plaignants pour avoir effectué des heures supplémentaires sans autorisation sont annulés, compte tenu de l'inexistence d'une règle exigeant une autorisation explicite de l'employeur et de l'imprécision des directives émises par le contremaître avant ses vacances.
Les plaignants étaient peintres dans une aluminerie. Avant de partir en vacances, leur contremaître leur a donné la directive de rester le soir, la semaine suivante, afin de peindre les lignes du stationnement, d'acheter la peinture et de louer la machine requise. Comme les travaux n'étaient pas terminés le jeudi soir, les plaignants les ont achevés le vendredi et le samedi. Ils ont effectué chacun 50 heures supplémentaires en plus de leur semaine normale de 40 heures; les autres peintres étaient en vacances. L'employeur leur a remis un avis disciplinaire, leur reprochant d'avoir pris l'initiative d'effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sans autorisation ni justification le vendredi de même que le samedi et d'avoir ainsi entraîné des coûts supplémentaires. De son côté, le syndicat prétend qu'il y avait eu autorisation.
Décision
Les directives laissées par le contremaître, tant à son remplaçant qu'à l'un des plaignants, étaient imprécises. Malgré l'absence d'une autorisation expresse, les plaignants pouvaient raisonnablement croire qu'ils avaient l'autorisation implicite de faire les heures supplémentaires. En fait, le contremaître a omis de bien planifier les travaux à exécuter ou de bien faire connaître sa planification. Il a préparé des billets de travail qu'il a laissés à son remplaçant, lui disant qu'il pourrait y avoir des heures supplémentaires sans en préciser le nombre. Il n'a pas donné de directives quant à la possibilité de délivrer de nouveaux billets de travail pour d'autres aires de stationnement que celles indiquées. D'autre part, les plaignants reconnaissent qu'ils savaient que les heures supplémentaires devaient être autorisées. Cependant, ils n'ont pas commis de faute puisque aucune directive ne précisait la forme requise de cette autorisation. Une autorisation implicite était suffisante pour permettre aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires. De plus, l'employeur reconnaît la validité d'une telle autorisation puisqu'il ne reproche pas les heures supplémentaires effectuées durant la semaine, alors que le remplaçant du contremaître affirme ne pas les avoir autorisées expressément. Par ailleurs, si l'employeur avait pris tous les faits en considération, il n'aurait pas conclu que les plaignants étaient fautifs. Afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise, il devait adopter une approche administrative plutôt que disciplinaire, soit en mettant en place une directive générale pour l'avenir. Les avis disciplinaires sont donc annulés.
Syndicat des employés d'Énergie électrique, Québec, section locale 1926 et Rio Tinto Alcan inc. (Énergie électrique), (griefs individuels, Gilles Boily et un autre). SOQUIJ AZ-50553055
RECOURS CIVILS
En l'absence totale de preuve, le simple fait que l'employeur n'ait pas répondu à la mise en demeure de la Commission des normes du travail ne peut suffire pour lui imputer la mauvaise foi, la négligence ou le manque de collaboration qui doivent être présents afin de justifier le paiement de l'indemnité de 20 % prévue à l'article 114 de la L.N.T.
La Commission des normes du travail réclame, pour le compte du plaignant, un salaire et des congés annuels impayés ainsi qu'une indemnité de préavis et, pour son propre compte, la somme de 877 $ en vertu de l'article 114 de la L.N.T. D'abord embauché à titre de commis-livreur, le plaignant a été chargé par ses supérieurs de mettre de l'ordre dans l'entrepôt. Il soutient que, du 25 décembre 2005 au 28 octobre 2006, il a effectué plusieurs heures supplémentaires, qu'il a notées dans un calepin. Au moment de son congédiement, le 18 décembre suivant, l'employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires. Ce dernier affirme que celles-ci n'avaient pas été autorisées. Il prétend en outre que le plaignant a été congédié pour une cause juste et suffisante, soit avoir fumé dans l'établissement malgré plusieurs avertissements. Ce motif est nié par le plaignant.
Décision
Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir de réclamation pour le paiement d'heures supplémentaires lorsqu'elles ont été effectuées sans autorisation et à l'insu de l'employeur. Par contre, si ces heures sont travaillées à la connaissance de ce dernier, elles doivent être rétribuées. Il appartient à l'employeur de limiter, à l'aide des instructions appropriées, le nombre d'heures de travail que le salarié est autorisé à accomplir. Une autorisation implicite d'effectuer des heures supplémentaires peut s'inférer des circonstances et des fonctions confiées au salarié. En l'espèce, le plaignant a vu ses responsabilités accrues lorsque l'employeur lui a demandé de mettre de l'ordre dans l'entrepôt. Il affirme qu'il a dû travailler un plus grand nombre d'heures afin d'être en mesure d'accomplir toutes ses tâches. La gérante a témoigné l'avoir autorisé à effectuer des heures supplémentaires. Sa version est crédible et elle corrobore celle du plaignant. Il y a donc lieu d'accueillir cette réclamation. Par ailleurs, le relevé d'emploi remis au plaignant fait état d'une démission. Dans sa défense, l'employeur a plutôt invoqué un congédiement pour motif sérieux. Ses versions contradictoires minent sa crédibilité. La version du plaignant est retenue, notamment parce qu'il n'avait aucun motif de quitter son emploi. Par conséquent, il a droit au préavis prévu à la Loi. Les congés annuels impayés sont également dus. Enfin, l'indemnité réclamée à titre de pénalité en vertu de l'article 114 de la L.N.T. n'est pas accordée. Selon la jurisprudence, la Commission devait démontrer qu'elle y avait droit en raison du comportement de l'employeur à son endroit. Or, elle n'a présenté aucune preuve quant aux raisons ayant motivé son choix de réclamer le paiement de cette indemnité. En l'absence totale de preuve, le simple fait que l'employeur n'ait pas répondu à la mise en demeure ne peut suffire pour lui imputer la mauvaise foi, la négligence ou le manque de collaboration qui doivent être présents afin de justifier cette pénalité.
Commission des normes du travail c. Centre de décoration des sols inc., SOQUIJ AZ-50547354
L'ex-directrice générale d'un organisme sans but lucratif doit rembourser 36 473 $ pour des heures supplémentaires qu'elle s'est fait payer sans autorisation; par ailleurs, compte tenu de la gravité de ses manquements et de l'importance de son poste, l'employeur était fondé à la congédier sans préavis.
L'employeur est une association professionnelle regroupant des massothérapeutes accrédités exerçant au Québec. Engagée à titre de directrice générale adjointe, la salariée a été nommée directrice générale le 1er décembre 2004. Elle a été congédiée en novembre 2005 en raison de son rendement insatisfaisant et de sa gestion déficiente. Après la rupture du lien d'emploi, l'employeur a constaté qu'elle s'était fait payer de nombreuses heures supplémentaires sans autorisation préalable de la part du conseil d'administration. Il réclame le remboursement de ces sommes. Se portant demanderesse reconventionnelle, la salariée réclame une indemnité tenant lieu de délai de congé.
Décision
Le recours de l'employeur n'est pas fondé sur la réception de l'indu, mais sur la violation de l'obligation de bonne foi. En effet, c'est la salariée, en sa qualité de directrice générale, qui a donné l'ordre de se verser des heures supplémentaires. Afin de trancher la réclamation de l'employeur, il y a lieu d'interpréter le contrat liant les parties ainsi que le document relatif aux conditions de travail, et ce, en fonction des principes d'interprétation prévus aux articles 1425 et ss. du Code civil du Québec (C.C.Q.). Le contrat prévoyait un salaire horaire (art. 9) ainsi qu'une semaine de travail de 37,5 heures (art. 11). Quant aux heures supplémentaires, c'est le document portant sur les conditions de travail qui en prévoit les modalités. Or, il ressort de l'examen des documents pertinents que, pour l'employeur, un organisme sans but lucratif, le travail en heures supplémentaires constituait une solution de dernier recours. Il n'était autorisé que dans les cas exceptionnels, et ce, par le supérieur immédiat. Permettre à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires sans autorisation ni limite viderait complètement de son sens l'article 11 du contrat, relatif à la durée de la semaine normale de travail. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l'accomplissement d'heures supplémentaires. D'autre part, on ne peut conclure que, par son comportement, le conseil d'administration avait entériné le paiement de celles-ci. La salariée devra donc rembourser la somme de 36 423 $.
Par ailleurs, l'article 2094 du Code prévoit qu'une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis un contrat de travail. En l'espèce, la salariée s'est approprié illégalement des sommes d'argent appartenant à l'employeur. Comme elle jouissait d'une autonomie professionnelle substantielle, elle devait faire montre d'une grande loyauté à l'égard de ce dernier. Le conseil d'administration — formé de bénévoles — devait compter sur sa directrice générale sans qu'il soit nécessaire de la surveiller constamment. En percevant des sommes alors qu'elle n'y avait pas droit et en refusant de répondre aux questions du conseil à ce sujet, la salariée a rompu le lien de confiance de façon irrémédiable, ce qui justifiait son congédiement. D'autre part, elle éprouvait de grandes difficultés en matière de gestion du personnel et a omis d'aviser le conseil d'administration qu'elle faisait l'objet de plaintes pour harcèlement psychologique de la part de deux ex-employées. Au surplus, elle a assuré elle-même le suivi de ces plaintes. Compte tenu de la gravité des manquements de la salariée et de l'importance de ses fonctions, l'employeur était fondé à résilier son contrat sans préavis.
Fédération québécoise des massothérapeutes c. Jacquart, SOQUIJ AZ-50556281
L'employeur doit rémunérer les heures supplémentaires à taux majoré car, même si la salariée — une préposée à la comptabilité — travaillait à domicile, ses heures de travail n'étaient pas « incontrôlables » au sens de l'article 54 paragraphe 4 de la L.N.T.
La salariée était préposée à la comptabilité et travaillait surtout à la maison. Elle affirme que les heures supplémentaires effectuées entre le 22 janvier et le 16 avril 2005 ne lui ont pas été rémunérées à taux majoré. Elle réclame 1746 $ en vertu des articles 52 et 55 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) ainsi que 2800 $, représentant le salaire impayé pendant qu'elle s'est absentée pour cause de maladie. Elle prétend que l'employeur a omis de lui remettre un relevé d'emploi, ce qui l'a privée de son droit de recevoir des prestations d'assurance-emploi pendant cette période d'invalidité.
Décision
Rien ne permet d'écarter l'évaluation que la salariée a faite des heures supplémentaires travaillées. L'employeur ne peut bénéficier de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 54 de la L.N.T. parce que, même si la salariée exécutait ses tâches à l'extérieur de l'établissement, ses heures de travail n'étaient pas incontrôlables; elles étaient plutôt incontrôlées. L'employeur, sans aucune vérification, se fiait tout simplement aux déclarations de la salariée à cet égard. En conséquence, cette partie de la réclamation est fondée. Par contre, la demande de paiement du salaire durant la période d'invalidité est rejetée. La Loi sur l'assurance-emploi établit un régime de prestations spéciales aux assurés qui ne peuvent travailler en raison de circonstances particulières, dont la maladie ou la grossesse. En l'espèce, même si la salariée avait eu droit à de telles prestations, leur valeur ne serait pas ce qu'elle réclame, car elle n'a pas tenu compte du délai de carence, ni de la rémunération assurable, ni du taux des prestations. De plus, une personne admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi doit manifester son intention de les recevoir. Lorsqu'un employeur refuse de remettre un relevé d'emploi, l'employé ne peut demeurer inactif. Il doit agir de façon raisonnable afin de s'assurer qu'il satisfait aux droits et aux obligations énoncés à la Loi, en particulier en s'adressant à la Commission de l'assurance-emploi du Canada. Une telle situation est prévue à l'article 19 (5) et (6) du Règlement sur l'assurance-emploi. En l'espèce, la salariée n'a rien fait. Elle ne peut avoir en droit civil plus de droits que ceux qu'elle aurait eus si elle avait présenté sa demande directement à la Commission.
Poirier c. Société immobilière Campiz ltée, SOQUIJ AZ-50551764
Tant en vertu de l'article 180 de la LATMP que de la convention collective, l'employeur ne pouvait exclure le plaignant de la distribution des heures supplémentaires pendant qu'il était en affectation temporaire en invoquant son incapacité à exercer son travail habituel.
Le plaignant, un opérateur de machine, a subi un accident du travail. Il a été mis en arrêt de travail, puis en affectation temporaire durant une semaine. Au cours de cette semaine, trois salariés ayant moins d'ancienneté que lui ont effectué des heures supplémentaires. Le plaignant avait la qualification requise pour effectuer le travail. Selon la convention collective, les heures supplémentaires sont réparties en fonction de l'ancienneté et de la capacité de faire le travail. Le syndicat allègue que l'employeur aurait dû offrir au plaignant les heures supplémentaires exécutées par ses collègues. La politique de l'employeur en matière d'heures supplémentaires énonce que celles-ci ne constituent pas un avantage relié à l'emploi. Elle prévoit également que ces heures ne sont pas offertes aux salariés en affectation temporaire, puisque ces derniers ne sont pas physiquement capables d'exécuter le travail. Le syndicat prétend que la politique de l'employeur n'est pas conforme à la convention, laquelle reprend les dispositions de l'article 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), relatif au maintien des avantages reliés à l'emploi pendant une assignation temporaire. Selon le syndicat, la possibilité de faire des heures supplémentaires est incluse dans les avantages d'un emploi. Les parties ont demandé à l'arbitre de ne statuer que sur la question de principe soulevée par le grief et de réserver sa compétence en ce qui a trait au quantum si celui-ci devait être accueilli.
Décision
La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP) relative à l'application de l'article 180 de la LATMP est claire : un travailleur en affectation temporaire a droit aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées n'eût été sa lésion professionnelle. La jurisprudence arbitrale sur l'application de la Loi abonde dans le même sens. En l'espèce, le but de la convention est de protéger le salarié affecté à des travaux légers contre une perte de salaire malgré son inaptitude à effectuer son travail habituel. Tout comme l'article 180, la convention crée une fiction. Dans ces circonstances, l'incapacité d'un salarié à accomplir son travail habituel ne peut donc être un motif valable pour ne pas lui reconnaître le salaire qu'il aurait reçu s'il avait exercé ce travail. En outre, la CLP a reconnu que les heures supplémentaires peuvent faire partie du salaire. L'employeur aurait donc dû appliquer la clause de la convention relative à la distribution des heures supplémentaires comme si le plaignant avait été dans son poste habituel. Quant à la détermination des heures supplémentaires que celui-ci aurait effectuées s'il avait continué à exercer son travail, il s'agit d'une question de preuve. Le grief est accueilli; l'arbitre réserve sa compétence en ce qui a trait au quantum.
Teamsters Québec, section locale 973 et Agropur, division Natrel (Claude Girard), SOQUIJ AZ-50517726
LÉSION PROFESSIONNELLE
Le droit aux heures supplémentaires qu’un employé aurait effectuées durant son absence en raison d’une lésion professionnelle
La possibilité d'être inscrit sur une liste de disponibilité pour être éventuellement de garde et recevoir une prime afférente constitue un avantage au sens de l'article 180 de la LATMP; le travailleur, un monteur de lignes temporairement affecté à un travail de patrouilleur de réseau, avait droit à cette prime, et sa plainte est accueillie.
Décision
La loi prévoit à l'article 255 de la LATMP une présomption en faveur du travailleur s'il peut démontrer qu'il a fait l'objet d'une mesure prohibée par l'article 32 dans les six mois de sa lésion professionnelle ou du moment où il a exercé un droit que lui confère la Loi. Lorsque la présomption s'applique, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a agi pour une autre cause juste et suffisante. En l'espèce, le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l'article 255. En effet, il a repris le travail le 2 juillet 2007 dans le cadre d'une assignation temporaire et, dès ce moment, il avait le droit de bénéficier du salaire et de tous les avantages liés à son emploi. C'est donc à partir de ce moment et non de celui de la survenance de la lésion professionnelle que le délai de six mois doit être calculé. Le tribunal ne retient pas l'argument de l'employeur selon lequel le recours à l'article 32 est inapproprié pour un travailleur qui dit avoir été privé du salaire ou d'un avantage en contravention de l'article 180 de la LATMP. À l'instar de la cause Crown Cork & Seal Canada Inc. et Deschamps (C.L.P., 2004-02-27), SOQUIJ AZ-50223656, C.L.P.E. 2003LP-336, [2003] C.L.P. 1593, il y a lieu de retenir que le recours à l'article 32 est approprié malgré les jugements rendus par la Cour d'appel sur la question. Quant à déterminer si le versement d'une prime de garde constitue du salaire ou un avantage au sens de l'article 180, il existe une similitude avec les heures supplémentaires reconnues comme un avantage lié à l'emploi. Ainsi, la possibilité d'être inscrit sur une liste pour être éventuellement de garde et recevoir une prime afférente peut constituer un avantage. Par ailleurs, comme il a été décidé dans l'affaire Crown Cork & Seal Canada Inc., l'expression « et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer » prévue à l'article 180 implique une fiction en vertu de laquelle il y a lieu d'analyser la situation d'emploi du travailleur comme s'il n'avait pas subi de lésion professionnelle. L'objectif étant de traiter le travailleur, quant au salaire et aux avantages liés à son emploi, de la même façon qu'il était traité avant sa lésion professionnelle. Le fait d'appliquer cette fiction écarte la jurisprudence selon laquelle, pour avoir droit à des heures supplémentaires, par exemple, un travailleur doit prouver que ces heures avaient été prévues et acceptées avant l'assignation temporaire. Il s'agit essentiellement d'une question de preuve, chaque cas devant être évalué à son mérite. En l'espèce, en appliquant cette fiction, le travailleur se serait vu offrir d'être sur la liste de garde et aurait accepté d'y être dans une proportion de 35 %, comme dans l'année précédant sa lésion professionnelle. Il s'agit d'un avantage dont il a manifestement été privé au moment où l'employeur ne lui a plus offert de figurer sur la liste de garde et donc de recevoir la prime. Aucune preuve ne permet de conclure que le travailleur aurait modifié ce pourcentage d'acceptation s'il n'avait pas été en arrêt de travail après avoir subi une lésion professionnelle. La plainte du travailleur est donc accueillie.
MICHEL ARÈS, partie requérante, et HYDRO-QUÉBEC, partie intéressée, SOQUIJ AZ- 50558784
Le législateur a voulu assurer à tout travailleur un revenu brut qui tient compte de l’ensemble de ses gains sous différentes formes; les heures supplémentaires effectuées de façon régulière font partie de la réalité dont il faut tenir compte afin d’établir le revenu servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR).
Dans le cadre de la révision quinquennale de son IRR réduite, le travailleur a transmis un relevé cumulatif pour 42 semaines indiquant qu'il avait reçu un salaire de 24 977 $. La CSST a donc annualisé ce montant et a conclu que le revenu net était de 26 880 $, lequel a été déduit du total de l'IRR réduite annuelle de 27 528 $ à laquelle il avait droit. La CSST a donc déclaré que le travailleur avait droit à une IRR annuelle de 648 $ ou 24,92 $ bihebdomadaire. L'instance de révision a confirmé cette décision. Le travailleur demande de déclarer que la révision de son IRR réduite ne doit pas prendre en considération les gains obtenus en effectuant des heures supplémentaires, puisque ces montants sont aléatoires et augmentent de façon non réaliste son revenu potentiel pour les cinq prochaines années.
Décision
L'article 67 de la LATMP prévoit que le revenu annuel brut d'un travailleur peut être établi, au moment où débute son indemnisation, en fonction du revenu tiré de son contrat de travail auquel peuvent être ajoutés les bonis, primes, heures supplémentaires et autres gratifications. Le législateur a voulu assurer à un travailleur un revenu brut qui tient compte de l'ensemble de ses gains sous différentes formes. Au moment où un travailleur n'est plus en mesure d'exercer son emploi, la CSST détermine un emploi convenable qu'il pourrait exercer ainsi qu'un revenu brut qu'il pourrait tirer d'un tel emploi convenable. Il ne s'agit plus de la réalité comme celle qui existe au moment où il subit son accident du travail, mais plutôt d'une fiction permettant d'évaluer son potentiel de gains. Toujours en vertu de l'article 67, la jurisprudence a retenu qu'il était possible d'utiliser le salaire établi à un contrat de travail et de l'établir sur une base annuelle par une projection faite en fonction du nombre de 52,14 semaines par année qu'un travailleur peut normalement accomplir comme temps de travail. Or, la révision du revenu réellement retiré par un travailleur dans les 12 mois qui précèdent la révision de son IRR réduite doit tenir compte non plus d'une projection ou du potentiel de gains, mais des revenus réellement retirés de l'emploi qu'il exerce au moment de cette révision. Dans ce contexte, l'annualisation peut s'appliquer, mais elle demeure exceptionnelle et c'est plutôt l'évaluation des gains réellement retirés par un travailleur dans les 12 mois précédant la révision qui doit être retenue comme méthode de calcul. En l'espèce, la méthode utilisée par la CSST a constitué à annualiser les revenus tirés par le travailleur dans les 42 semaines précédant la révision de son IRR. Elle a également ajouté à ce montant les revenus retirés en heures supplémentaires, les congés fériés payés et la rémunération reçue à titre de prime de vacances. Or, les relevés de paie du travailleur établissent un salaire de 35 588 $, soit un revenu légèrement inférieur à celui évalué par la CSST, mais comprennent 2329 $ reçus en heures supplémentaires. Le travailleur prétend que cette somme ne devrait pas être incluse dans ses revenus. Ces heures supplémentaires ont été effectuées, au cours de la période de référence, 33 semaines sur 52. Sa prétention selon laquelle il effectuait des heures supplémentaires de façon tout à fait particulière et sporadique ne peut donc être retenue. En effet, il a effectué des heures supplémentaires de façon régulière pendant la majorité des 52 semaines. Il faut donc tenir compte de ce revenu régulier qui démontre la capacité du travailleur à effectuer des heures supplémentaires en plus de ses heures normales de travail. Or, c'est cette réalité qui doit être prise en compte en vertu de l'article 55. La somme incluse à titre d'heures supplémentaires ne peut être retirée. Toutefois, c'est un revenu annuel brut de 35 588 $ qui devra être pris en considération par la CSST et transformé en revenu annuel net aux fins du calcul de l'IRR réduite et non le montant de 36 139 $ qu'elle avait initialement retenu.
Marcel Levasseur, partie requérante, et Bermatex inc., partie intéressée, SOQUIJ AZ-50547580
Les heures supplémentaires sont prises en compte pour d’établir l’IRR, mais cette méthode de calcul ne s’applique pas pour déterminer le revenu brut de l’emploi convenable.
À la suite de la détermination de l'emploi convenable que le travailleur pouvait exercer, la CSST a statué sur l'IRR réduite à laquelle il avait droit. Elle a ensuite reconsidéré cette décision et a déclaré que le salaire de l'emploi convenable était estimé à 49 664 $ et que le travailleur avait droit à une IRR en conséquence. L'instance de révision a confirmé cette décision. L'employeur demande de déclarer que le salaire de l'emploi convenable doit être estimé à 57 534 $.
Décision
En l'espèce, le tribunal doit déterminer si comptabiliser les heures supplémentaires lors du calcul du revenu annuel brut à retenir pour un emploi convenable constitue une erreur au sens de l'article 365. Les heures supplémentaires sont prises en compte lors du calcul du revenu brut d'un travailleur aux fins d’établissement de l'IRR à laquelle il a droit, conformément à l'article 67. Toutefois, aux fins de détermination du revenu brut annuel de l'emploi convenable, cette méthode de calcul ne s'applique pas. Il faut s'en remettre aux articles 49 et 50. Ces dispositions prévoient que l'on doit considérer le montant pouvant être tiré de l'exercice à temps plein de l'emploi convenable afin d'en fixer la rémunération. La jurisprudence a établi qu'il ne s'agit pas du salaire qu'un travailleur reçoit dans les faits, mais d'une estimation, qui doit cependant être juste, équitable et s'appuyer sur des données objectives. Ainsi, le revenu relié à l'exercice d'un emploi à temps partiel, qu'un travailleur pourrait exercer à temps plein, doit être calculé comme s'il était exercé à temps plein. Le présent tribunal est d'avis qu'il en va de même de l'exercice d'un travail pouvant comporter l'accomplissement d'heures supplémentaires, lequel doit, lui aussi, être considéré comme s'il était exercé à temps plein. Cependant, comptabiliser les heures supplémentaires va au-delà des heures habituelles d'un emploi exercé à temps plein. Il s'agit là d'une erreur justifiant la reconsidération de la décision conformément à l'article 365. Quant à la prétention de l'employeur voulant qu'il soit pénalisé par cette méthode de calcul, il faut rappeler que lors de la revalorisation de l'IRR, survenant deux ans après que le travailleur soit devenu capable d'exercer l'emploi convenable, les heures supplémentaires réellement exercées seront considérées conformément à l'article 54. En conséquence, la CSST était bien fondée à reconsidérer sa décision et de déclarer que le salaire de l'emploi convenable devait être estimé à 49 664 $.
Mittal Canada inc., partie requérante, et Jean Delisle, partie intéressée, SOQUIJ AZ-50541985
COMMENT TROUVER LES DÉCISIONS MENTIONNÉES DANS CET ARTICLE ?
On trouvera toutes les décisions mentionnées dans cet article dans les Banques de Juris.doc dans le site d’AZIMUT*.
Chacune des décisions mentionnées a une référence AZ (par exemple AZ-50233881).
Pour retrouver cette décision, il faut :
- accéder à l’écran Choix de Banque;
- utiliser la case Recherche par référence AZ;
- cliquer sur les triangles
.
* Pour toute question relative à l'utilisation d'AZIMUT, communiquez avec le Service d'aide aux utilisateurs au 514 842-AIDE ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE, de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi. Si vous n’êtes pas encore abonné à AZIMUT, profitez du rabais offert aux membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.
Monique Desrosiers, avocate, Coordonnatrice, Secteur droit du travail et droit social, Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Source : VigieRT, numéro 40, septembre 2009.